Rapport
 }
}
En bref
- Une étude inédite menée par le Comité Colbert et Bain & Compagnie révèle que les groupes de luxe européens consacrent en moyenne 3,1 % de leur chiffre d'affaires à la technologie, mais ce montant peut varier de 1,9 % à 5,5 %.
- Ces investissements peuvent être optimisés en alignant et hiérarchisant les dépenses selon les priorités de l’entreprise, en rationalisant les architectures de systèmes d’information et en adaptant le modèle de gestion des talents pour améliorer la productivité des équipes technologiques.
- À mesure que l'industrie gagne en maturité technologique, un partenariat renforcé entre direction générale et direction technologique sera également déterminant.
Artisanal, exclusif… et dopé à la technologie.
Le secteur du luxe a montré ces dernières années qu'il était capable d’adopter les technologies les plus récentes sans renier ses valeurs traditionnelles, ni perdre en pouvoir de séduction. Dans toute l'industrie, les outils numériques et d'analyse des données alimentent désormais une expérience client de plus en plus omnicanale, immersive et personnalisée. La technologie ouvre également de nouvelles perspectives dans d'autres domaines tels que la manufacture, la gestion des flux logistiques, la prévision des ventes ou la gestion des stocks.
En collaboration avec
En collaboration avec
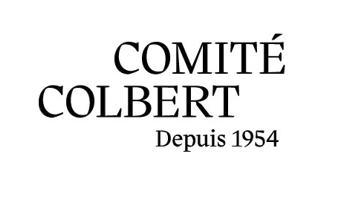
Mais si les initiatives liées au numérique et aux données représentent désormais une part non-négligeable des coûts dans la plupart des groupes de luxe, les dépenses technologiques restaient difficiles à évaluer dans le secteur en l’absence de données fiables. Étalonner les stratégies d'investissement par rapport à celle de leurs concurrents, voire même d'autres secteurs, constituait un exercice complexe pour les équipes dirigeantes.
Pour aider les acteurs du luxe à mieux mesurer la valeur de la technologie, Bain & Compagnie et le Comité Colbert, l'association française des maisons de luxe, ont fait le choix cette année d’élargir leur champ d'étude au-delà de l'innovation de rupture, pour mener une analyse approfondie des fondations technologiques et des stratégies d'investissement dans le secteur.
Notre rapport s’appuie sur une enquête quantitative et des entretiens réalisés auprès des dirigeants des principaux acteurs européens du luxe, parmi lesquels figurent des dirigeants de maisons et de groupes tels que Chanel, Hermès, Kering, LVMH, Richemont, Bonpoint, Longchamp, Christian Louboutin, Messika ou Rochas.
Une conviction forte chez les acteurs du luxe ressort de notre étude : la performance technologique est essentielle à leur réussite à long-terme. 85 % des directeurs généraux estiment que la technologie est importante pour la mise en œuvre de leur stratégie, et 8 % supplémentaires la jugent même critique.
Par ailleurs, plus des trois quarts des directeurs généraux et directeurs de systèmes d’information interrogés considèrent la technologie comme une fonction stratégique, pleinement intégrée dans les décisions-clés de leur entreprise.
D'autres données témoignent de la montée en maturité technologique du secteur. Par exemple, 78 % des directeurs généraux et des directeurs des systèmes d’information interrogés se disent satisfaits de l'expertise de leurs équipes technologiques, tandis que 80 % estiment que les équipes métiers et technologiques collaborent efficacement sur les projets du quotidien – un chiffre qui atteint même 88 % pour les grands projets de transformation. Mieux encore, 93 % des répondants affirment que les collaborateurs de l’entreprise sont ouverts à l'usage de la technologie dans leur travail au quotidien.
Pour un secteur fondé sur des siècles de savoir-faire artisanal, sans le moindre écran à l'horizon, c’est une avancée majeure. Mais le chemin reste encore long : seulement 37 % des entreprises interrogées estiment disposer aujourd’hui largement des capacités technologiques et des données nécessaires pour mettre en œuvre leur stratégie (voir Graphique 1).


D’autre part, l’actualité du luxe semble favorable à une accélération de la transformation technologique du secteur. Le ralentissement du marché pousse les dirigeants à optimiser l'allocation des ressources dans l’ensemble de leurs activités, y compris au sein de la fonction technologique. Parallèlement, l'essor des outils d'Intelligence Artificielle ouvre la voie à des gains de productivité significatifs dans toutes les fonctions, au service d’une croissance rationalisée.
Notre analyse du déploiement de la technologie dans le secteur du luxe met en évidence une double opportunité pour maximiser son pouvoir transformateur et la performance à long terme. D'une part, notre étude des investissements technologiques – à la fois au sein du secteur du luxe et par rapport à d'autres industries – montre que certaines entreprises pourraient tirer profit d’un ajustement de leur stratégie d'investissement. D'autre part, une collaboration renforcée entre le directeur général et le directeur des systèmes d’information peut aider les groupes de luxe à faire émerger des avantages concurrentiels, à l’heure où l'industrie entre dans une nouvelle phase de maturité technologique.
Freinée par un contexte géopolitique et économique compliqué, la demande de biens et d’expériences de luxe devrait rebondir à terme, portée à la fois par la croissance attendue du nombre de consommateurs fortunés et par l'attrait durable du secteur. Face à ces incertitudes actuelles, les équipes dirigeantes cherchent à réaliser des économies dans l'ensemble de leurs activités mais elles ne peuvent pas réduire leurs ambitions en matière de technologie. À mesure que celle-ci s’instille dans les entreprises, les maisons de luxe doivent renforcer leurs fondations technologiques pour saisir les opportunités de croissance et de rentabilité de demain, tout en répondant aux attentes d’une clientèle de plus en plus familière avec les outils et usages numériques.
Comment le luxe investit dans la technologie aujourd'hui
Il n'existe pas de modèle unique en matière d'investissement technologique dans le luxe. Les dépenses dépendent de facteurs tels que le modèle organisationnel (degré de centralisation ou d’autonomie locale des fonctions), les catégories de produits (les besoins étant différents pour la joaillerie, la mode, la beauté, les accessoires, etc.) ou encore l'historique des acquisitions. En moyenne, notre étude montre que les acteurs du luxe consacrent 3,1 % de leur chiffre d'affaires annuel à la technologie, englobant les coûts d'exploitation, les investissements (CapEx) et les charges de personnel. Les écarts par rapport à cette moyenne sont toutefois significatifs : à une extrémité du spectre, les dépenses descendent à 1,9 % du chiffre d'affaires, tandis que le niveau le plus élevé peut atteindre 5,5 % (voir Graphique 2).


Notes: Les grandes entreprises sont définies comme comptant plus de 3 500 équivalents temps plein.
Source: Enquête Comité Colbert et Bain & Company 2025Les économies d'échelle ne semblent pas encore avoir été pleinement réalisées : les grandes entreprises ont tendance à consacrer en proportion la même part de leur chiffre d'affaires à la technologie que les plus petites. Cela s'explique en partie par le fait que les principaux acteurs de l'industrie se sont développés par acquisitions, et peuvent ensuite peiner à concrétiser les synergies, compte tenu de l'identité et de l'autonomie propres à chaque marque. Les systèmes technologiques historiques, ainsi que le recours généralisé à des prestataires externes souvent coûteux, peuvent constituer des freins additionnels.
À l'avenir, la plupart des groupes prévoient une poursuite de la croissance de leurs investissements technologiques, notamment portée par des domaines tels que l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité ou la modernisation des systèmes centraux : 60 % des acteurs que nous avons interrogés prévoient ainsi une hausse de plus de 5 % en valeur de leurs dépenses technologiques dans les 2 à 3 prochaines années, dont 28 % qui anticipent même une augmentation supérieure à 10 %.
Nous avons distingué deux catégories de dépenses : celles liées au fonctionnement des activités et des solutions existantes (« run ») et celles consacrées aux initiatives visant à moderniser en profondeur l'infrastructure technologique et/ou à porter une véritable transformation (« change »). Nous avons constaté que les entreprises de luxe consacrent encore une part légèrement plus importante de leur budget technologique à la catégorie « Run » que d’autres secteurs. En moyenne, les entreprises interrogées allouent 63 % de leur budget technologique au « run », contre seulement 37 % aux initiatives de « change ». Dans d'autres industries, la part des dépenses consacrées aux projets de modernisation tend à être plus élevée, atteignant parfois près de 50 %. (voir Graphique 3).


Notes: Les coûts de « Run » (fonctionnement) englobent les dépenses destinées à entretenir les systèmes existants et à apporter des modifications mineures ; les coûts de « Change » (transformation) incluent les mises à niveau majeures et les investissements informatiques visant à soutenir l'expansion de l’entreprise et à permettre de nouveaux modèles ou stratégies commerciales.
Source: Enquête Bain ITeS, Janvier 2025 (n=262); Enquête Comité Colbert et Bain & Company 2025Cette part plus faible des dépenses consacrées aujourd’hui au « change » dans le luxe s'explique avant tout par le fait que le secteur a engagé sa transition numérique plus tard que d'autres industries, avec encore un effort de modernisation à fournir. Il convient également de noter que la proportion allouée aux dépenses de « change » peut varier de 15 % à 55 % selon les entreprises interrogées. Celles en haut de la fourchette affichent donc des caractéristiques similaires aux entreprises de secteurs technologiquement plus mûrs que le luxe : elles ont réussi à dégager de la capacité de financement d’innovation, en ayant progressé sur des chantiers fondamentaux tels que la refonte de leurs systèmes historiques.
La maîtrise des coûts de « run » reste complexe, car ils évoluent de pair avec la croissance de l'activité et sont alourdis par divers facteurs, tels que l'élévation des attentes des clients ou la prolifération des systèmes informatiques. Les équipes dirigeantes doivent néanmoins travailler à accroître l’efficacité de chaque euro dépensé en « run », en réduisant les coûts unitaires de technologie afin de libérer une part plus importante du budget pour la transformation. Certaines maisons de luxe interrogées affichent une forte ambition en la matière, en particulier celles dont les directeurs généraux sont perçus par leur directeur des systèmes d’information comme étant moteurs sur les sujets technologiques.
Notre étude met en évidence un autre domaine où le luxe se distingue des autres secteurs dans ses dépenses technologiques : les groupes de luxe consacrent encore une part plus importante de leurs investissements de « change » aux initiatives axées sur la relation client : 40 %, contre respectivement 32 % et 36 % dans la distribution et les biens de consommation (voir Graphique 4).


Notes: Pour le luxe, les activités axées sur la relation client incluent le commerce de détail et de gros, les ventes en ligne, les centres de contact, le marketing ainsi que les ventes et services multicanaux ; les activités cœurs de métier regroupent la logistique et l'approvisionnement, la production et le merchandising ; les fonctions support incluent la finance, les RH, le juridique et l'administration
Source: Enquête Bain ITeS, Janvier 2025 (n=262); Enquête Comité Colbert et Bain & Company 2025À l'inverse, ils consacrent une part plus faible de leurs dépenses de « change » à la technologie d'entreprise, aux données et à l'IA : seulement 21 %, contre respectivement 26 % et 36 % dans les secteurs des biens de consommation et de la distribution. Ce déséquilibre reflète en partie l’accélération à marche forcée, pendant la pandémie du Covid-19, du développement des canaux numériques et des réseaux logistiques, alors que les boutiques physiques étaient fermées. Notre enquête montre toutefois que les directeurs généraux et les directeurs des systèmes d’information du secteur du luxe comptent désormais réorienter leurs investissements technologiques vers des domaines moins directement visibles par les clients, tels que les données et l’IA, des volets essentiels à la création d’une expérience client haut de gamme.
« Les investissements récents ont principalement porté sur l’innovation front-end. Nous entrons désormais dans une phase clé, qui exige une attention renforcée sur la donnée, l’intelligence artificielle, les opérations, la chaîne d’approvisionnement et la transformation du back-office. »
Optimiser les dépenses technologiques de demain
Il reste encore une importante marge de manœuvre pour optimiser les dépenses technologiques. La première grande opportunité concerne la hiérarchisation des investissements et leur alignement sur les impératifs de l’entreprise. Notre étude suggère que certains directeurs des systèmes d’information du secteur du luxe ne disposent pas d'une vision suffisamment claire de ces priorités stratégiques globales et de leur articulation avec la fonction technologique, notamment dans les maisons ou groupes où le directeur général n'est pas un moteur de la transformation technologique.
Lorsque nous avons demandé aux directeurs des systèmes d’information ce qu’ils attendaient le plus de la part de leur directeur général ou du comité exécutif, une réponse s’est nettement dégagée dans les entreprises où le directeur général est moins investi dans la technologie : plus de la moitié de ces directeurs des systèmes d’information ont exprimé le besoin d’« une feuille de route claire, avec des objectifs précis ». En revanche, dans les entreprises où le directeur général joue un rôle moteur dans la technologie (soit 50 % des cas étudiés), les directeurs des systèmes d’information ne semblent pas souffrir du même manque de clarté quant aux priorités de l’entreprise et au rôle attendu pour les soutenir (voir Graphiques 5a et b).


Notes: Implication technologique du directeur général, telle qu’évaluée par le directeur des systèmes d’information en fonction de son rôle dans la transformation technologique
Source: Enquête Comité Colbert et Bain & Company 2025

Notes: ication technologique du directeur général, telle qu’évaluée par le directeur des systèmes d’information en fonction de son rôle dans la transformation technologique
Source: Enquête Comité Colbert et Bain & Company 2025Dans bien des cas, les directeurs généraux auraient bénéfice à veiller à ce que les priorités de la maison soient transmises aux équipes technologiques de façon suffisamment précise pour être traduites en actions concrètes et intégrées aux processus opérationnels. Eclaircir dès maintenant les zones d’ombre et combler les lacunes d'information pourrait constituer un véritable levier de performance, à l’heure où les défis se multiplient.
Parallèlement, l'impact réel des dépenses technologiques reste encore insuffisamment mesuré. La plupart des directeurs généraux se montrent relativement optimistes quant au retour sur investissement (ROI) de ces dépenses : 77 % estiment que leurs attentes en matière de ROI sont satisfaites pour la plupart ou la totalité de leurs initiatives. Cependant, bien que l'industrie progresse vers la mise en place de méthodes de mesure plus sophistiquées, celles-ci reposent souvent sur une vision partielle des coûts et des bénéfices des projets technologiques, plutôt que sur une approche véritablement complète, capable de prendre en compte l’ensemble des impacts sur la chaîne de valeur.
« La cybersécurité est une priorité majeure dans le secteur du luxe : elle met en péril la continuité des activités et la réputation des marques — bien au-delà de la simple perte de données. »
La deuxième grande opportunité pour optimiser les dépenses concerne la rationalisation des architectures technologiques. Cela implique d’abord d'éliminer les doublons et de moderniser les systèmes hérités. Souvent, il est également possible de s'appuyer davantage sur des solutions et des plateformes partagées entre marques, catégories, entités ou régions. L’objectif est de réaliser des économies d'échelle sans compromettre ni l'autonomie, ni la capacité d'innovation génératrice de croissance des différentes maisons, lignes de métier ou unités locales.
Les achats technologiques et le suivi des coûts informatiques pourraient eux aussi être davantage centralisés. Parallèlement, les équipes dirigeantes devraient systématiser la diffusion des bonnes pratiques en matière d'innovation, en déployant à l’échelle du groupe les projets pilotes technologiques les plus prometteurs initiés et pilotés localement.
Il existe une troisième manière d’optimiser les dépenses : trouver le modèle optimal de gestion des talents pour libérer la productivité des équipes d’ingénierie. Notre étude révèle qu’au sein des maisons de luxe, les fonctions technologiques allouent actuellement 68 % de leurs dépenses de « Change » à des prestataires externes. Ce chiffre est supérieur à ce que l’on observe dans d'autres industries, où la proportion pour de telles initiatives de transformation se situe entre 44 % et 61 % (voir Graphique 6).


Notes: Les dépenses de “change” (transformation) incluent les mises à niveau majeures et les investissements informatiques destinés à soutenir l'expansion de l’activité et à permettre de nouveaux modèles ou stratégies commerciales.
Source: Enquête Bain ITeS Survey, Janvier 2025 (N=262); Enquête Comité Colbert et Bain & Company 2025Pour gagner en agilité et en autonomie, certains groupes de luxe pourraient envisager de réduire le nombre et la part de partenaires externes pour internaliser certaines compétences technologiques stratégiques, surtout lorsque les coûts des fournisseurs sont élevés et difficiles à maîtriser. L'internalisation est particulièrement pertinente dans les domaines où une véritable différenciation est possible, tels que la cybersécurité, le développement front-end et l'IA/machine learning. En parallèle, les entreprises devraient également tirer parti des nouveaux outils disponibles – par exemple les assistants de codage basés sur l’IA – pour augmenter la productivité de leurs ingénieurs informatiques.
L’un des dirigeants du luxe que nous avons interrogés a résumé ainsi la manière de trouver le juste équilibre entre ressources internes et recours à des prestataires externes « Ce qui importe, ce n’est pas tant le pourcentage d’externalisation, mais les compétences clés conservées en interne — comme l’architecture ou la gestion des fournisseurs. Les responsables internes doivent être capables de challenger efficacement leurs partenaires externes »
Nous ne sous-estimons pas le défi que représentera le recrutement pour de nombreuses entreprises de luxe qui s’engageront dans cette démarche d'internalisation, qu'il s’agisse de chercher des talents sur leur marché local ou sur d'autres marchés plus lointains offrant des viviers plus vastes – et parfois plus concurrentiels. Dans des domaines comme la data ou le pilotage de programmes ERP, la concurrence pour attirer les meilleurs profils est féroce, et d’autres secteurs exercent souvent une attraction forte. Les groupes de luxe peuvent toutefois contourner cette difficulté en valorisant les fonctions technologiques en interne, en offrant des parcours de développement à long terme aux talents de la technologie et en élargissant les recrutements au-delà de l'industrie du luxe et de la mode (une approche qui présente en outre l'avantage d'apporter des perspectives nouvelles).
Les trois leviers mentionnés dans cette partie – aligner plus étroitement les dépenses avec les priorités de l’entreprise, rationaliser les architectures et revoir le modèle de gestion des talents – peuvent générer des économies significatives pour les groupes de luxe, sans compromettre le développement continu de leurs compétences et capacités technologiques. Les équipes dirigeantes doivent éviter les simples mesures de réduction des coûts, qui pourraient entraver cette progression essentielle.
Comment les directeurs généraux et les directeurs des systèmes d’information peuvent avancer ensemble
Du point de vue d'un directeur général, la fonction technologique n’est pas une composante de l'organisation comme les autres. Bien qu'elle absorbe donc une part importante du chiffre d'affaires du groupe (de 2 % à 5 % chaque année), son fonctionnement peut être moins bien maîtrisé qu’une fonction comme le marketing. Cette relative méconnaissance peut parfois entraîner un engagement inégal de la part du directeur général – avec une alternance de phases où la fonction technologique est laissée à elle-même, suivies de phases de contrôle intense.
« Je me plonge facilement dans de nombreux sujets, du merchandising à la finance, et j’en comprends aisément les enjeux. La technologie, en revanche, est un domaine plus complexe pour moi, car je n’ai pas le même bagage. Je me concentre donc davantage sur les résultats que sur les aspects techniques. »
De leur côté, les directeurs des systèmes d’information sont confrontés à leurs propres défis. Si les groupes de luxe excellent dans l’identification et la valorisation des talents créatifs, les talents technologiques, eux, ne bénéficient pas encore de la même crédibilité interne. Souvent, les directeurs des systèmes d’information du luxe sont perçus davantage comme des facilitateurs opérationnels que comme des leaders stratégiques. « La technologie est encore trop souvent perçue comme une fonction support », admet un directeur général du secteur. Notre étude montre également que les directeurs des systèmes d’information du luxe siègent beaucoup moins fréquemment au comité exécutif que dans d'autres secteurs, notamment la distribution (voir Graphique 7).


Notes: La distribution inclut la vente de produits alimentaires et les enseignes spécialisées par secteur, mais exclut la mode de masse.
Source: Enquête Comité Colbert et Bain & Company 2025; bibliothèque Bain de benchmarksDans une certaine mesure, ces défis constituent des étapes difficiles mais nécessaires à l’évolution de la fonction technologique dans le secteur du luxe. À mesure que la maturité du secteur progresse dans ce domaine, la compréhension et l'engagement technologique des directeurs généraux et autres dirigeants devraient s'accroître, tout comme le rôle stratégique du directeur des systèmes d’information.
Mais les directeurs généraux et directeurs des systèmes d’information ne peuvent pas se contenter d’attendre que les choses changent. Pour exploiter pleinement le pouvoir de transformation de la technologie, ils doivent trouver des moyens de collaborer de manière fluide et de catalyser le changement. Cette collaboration doit notamment passer par un dialogue continu entre le directeur général et le directeur des systèmes d’information sur des enjeux critiques : feuille de route technologique, priorisation des investissements et optimisation des dépenses.
« Chez nous, le directeur des systèmes d’information est pleinement intégré au business et siège au comité exécutif — car l’alignement entre transformation métier et transformation technologique est indispensable. »
Renforcer la formation technologique des dirigeants est essentiel pour créer un partenariat plus efficace entre directeur général et directeur des systèmes d’information. De manière surprenante, seuls 52 % des directeurs généraux et directeurs des systèmes d’information interrogés indiquent que la plupart des dirigeants de leur groupe ont été formés aux grands enjeux technologiques. Des programmes immersifs de type boot camps, immersions universitaires, démonstrations de start-up ou conférences spécialisées devraient être déployés pour accroître la culture digitale et l’exposition aux tendances émergentes (telles que le vibe coding). Les groupes de luxe pourraient également être amenés à ajuster leurs dispositifs de gouvernance et de reporting pour fluidifier le dialogue entre la technologie et les métiers.
Au-delà du renforcement de la relation entre le directeur général et le directeur des systèmes d’information, les groupes de luxe devraient aussi envisager de structurer davantage d'équipes selon le modèle Produit (« product model »), popularisé par les entreprises du secteur numérique, où experts métiers et technologiques travaillent en tandem. D’après notre étude, c’est dans les activités en contact direct avec le client que l'adoption de ce modèle est la plus avancée dans le luxe (55 % d'adoption), alors qu’elle reste plus limitée dans les opérations cœur de métier (25 %). La généralisation d’équipes véritablement transverses et multi-fonctionnelles à tous les niveaux de la chaîne de valeur nécessitera – et favorisera en retour – la diffusion d’une meilleure culture technologique à tous les niveaux de l'organisation.
« Les équipes tech et data sont d’autant plus performantes et en valeur ajoutée qu’elles ont une parfaite compréhension du “pourquoi” de leur travail. Il est donc crucial de les impliquer en amont dans les enjeux et les raisonnements d’affaires. »
Pistes de réflexion pour démarrer
Face à des exigences de rentabilité toujours plus fortes dans le secteur du luxe, les équipes dirigeantes doivent impérativement optimiser leurs investissements technologiques, afin de laisser la place à une innovation porteuse de croissance sans compromettre l'excellence au quotidien. Les directeurs généraux et les directeurs des systèmes d’information peuvent dès aujourd'hui amorcer cette démarche en se posant les questions suivantes :
Pour les directeurs généraux :
- Ai-je un dialogue régulier et structuré avec mon directeur des systèmes d’information ?
- Suis-je en mesure de poser les bonnes questions et d’alimenter la discussion lorsqu’il s’agit de sujets technologiques ?
- Ai-je une vision claire des principales priorités technologiques pour mon entreprise et de leur place dans notre feuille de route ?
- Investissons-nous judicieusement dans ce qui est vraiment essentiel pour l'entreprise et ce qui la distingue de ses concurrents ?
- Comment puis-je soutenir notre directeur des systèmes d’information dans l’optimisation du retour sur investissement ?
- Les responsables métiers collaborent-ils étroitement avec le directeur des systèmes d’information pour améliorer l'impact pour notre entreprise ?
Pour les directeurs des systèmes d’information :
- Suis-je intégré(e) aux instances clés de partage d'informations et de prise de décision, et ai-je le sentiment d’être habilité(e) à y contribuer ?
- Ai-je à ma disposition des outils et des critères solides pour quantifier et prioriser les initiatives technologiques ?
- Devrais-je renforcer la discipline budgétaire ? Est-ce que j’offre à nos dirigeants suffisamment de visibilité sur les dépenses technologiques et la logique qui les sous-tend ?
- Pouvons-nous accélérer la simplification de notre patrimoine technologique ?
- Est-ce que j’échange régulièrement avec la direction sur les dernières tendances technologiques ?
- Avons-nous une vision claire de l’équilibre cible entre talents technologiques internes et externes, et savons-nous comment attirer, fidéliser et développer ces talents ?
Compte tenu des progrès réalisés ces dernières années, les équipes dirigeantes peuvent avoir confiance en leur capacité à franchir cette prochaine étape. Une nouvelle ère de dépenses technologiques plus ciblées est désormais à la portée du secteur.